
Une Chine à deux vitesses
Des régions côtières de plus en plus riches, des terres intérieures toujours aussi pauvres, des disparités sociales de plus en plus criantes. Deux décennies après son « ouverture au monde »- Mao est mort en 1976, et dès 1978 Deng Xiaoping traite ouvertement avec l’Occident-, la Chine n’en finit plus de cultiver le fâcheux paradoxe de son exceptionnel développement. Une croissance moyenne de 8,2 % depuis 1978, mais une répartition très inégale des richesses. Des disparités régionales qui ne font que se creuser et qui compliquent les choix de réforme économique du nouveau gouvernement de Zhu Rongji.
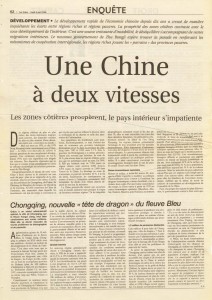 Géographiquement, le drame de cette vaste Chine à deux vitesses se lit aisément sur une carte du pays : plus on se rapproche de la côte orientale, plus les provinces sont riches. C’est le cas des provinces du Guangdong, du Fujian, du Zhejiang, de Shanghai, du Jiangsu, du Shandong et du Liaoning. Au-delà commence la Chine de l’intérieur, une immensité dans laquelle les investisseurs ont mis du temps à s’aventurer et qui vit plus que partout ailleurs le divorce entre la civilisation de la charrue et celle des autoroutes de l’information.
Géographiquement, le drame de cette vaste Chine à deux vitesses se lit aisément sur une carte du pays : plus on se rapproche de la côte orientale, plus les provinces sont riches. C’est le cas des provinces du Guangdong, du Fujian, du Zhejiang, de Shanghai, du Jiangsu, du Shandong et du Liaoning. Au-delà commence la Chine de l’intérieur, une immensité dans laquelle les investisseurs ont mis du temps à s’aventurer et qui vit plus que partout ailleurs le divorce entre la civilisation de la charrue et celle des autoroutes de l’information.
Les symptômes du tiraillement sont nombreux. Economiquement, ce sont d’abord des taux de croissance par province totalement hétérogènes (13,1 % dans la province du Zhejiang entre 1981 et 1994, mais 5,1 % dans la province du Heilongjiang à la même période). Quant aux revenus par habitant, ils sont de 50 % plus élevés dans les régions côtières, pour peu que les statistiques aient un sens. En 1995, le PIB par habitant était de 7.994 yuans en région côtière (soit environ 6.000 francs), 3.875 yuans en région centrale et 2.840 dans l’ouest de la Chine. Le décalage ne cesse de s’accentuer et pourrait atteindre 40 % à la fin du siècle. Socialement, les conséquences, en termes d’accès à l’éducation notamment, sont écrasantes. Le destin d’un enfant chinois dépend de son lieu de naissance.
La Chine pouvait-elle réussir son ouverture vers le monde extérieur sans prendre le risque de favoriser certaines régions ? Si les inégalités géographiques existaient avant la fin des années 70, elles se sont exacerbées au cours des deux dernières décennies. Un phénomène relativement naturel : au début de l’ère Deng Xiaoping, les régions côtières présentaient l’avantage de leur proximité avec les marchés internationaux. Elles disposaient d’infrastructures plus développées et d’une force de travail mieux éduquée. Le gouvernement chinois était logiquement enclin à partir des conditions existantes pour appliquer ses politiques préférentielles. Il a ainsi ouvertement encouragé les investissements étrangers dans le sud du pays. Et creusé l’écart entre les deux Chine.
Retour en arrière : à la fin des années 80, alors que la Chine s’apprête à modifier sa politique d’autosuffisance pour s’ouvrir à l’extérieur, les dragons économiques voisins cherchent, eux, à réduire leurs coûts. Par une bonne concordance des temps, la Chine ouvre à partir de 1979 ses zones économiques spéciales (Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Shantou, puis Hainan), au moment précis où Hong Kong, Singapour, Taiwan un peu plus tard sont à la recherche de lieux de transformation et d’assemblage extérieurs avec une main d’oeuvre bon marché. Pour attirer les investissements, Pékin accorde aux sociétés à capitaux étrangers établies dans les zones économiques spéciales et dans quatorze villes côtières un taux de l’impôt sur le bénéfice particulièrement bas (15 %). Les investissements étrangers affluent et permettent aux régions côtières de réussir un miracle économique en dix ans. Avec seulement 14 % de la surface du pays mais tout de même 41 % de sa population, elles génèrent aujourd’hui 59 % de la richesse nationale. Mais les autorités du pays admettent aujourd’hui que ces régions n’ont rempli que la moitié d’un contrat tacite : elles ont conservé pour elles les bénéfices de l’ouverture économique, oubliant par là même de servir de courroie de transmission au développement de l’ensemble de la Chine.
Face à la grogne des régions les plus défavorisées, le gouvernement central a bien senti que, après des années de « laisser-faire », il était temps d’agir pour redéfinir les relations du centre et des régions. « Nous avons réalisé que si le gouvernement central n’intervenait pas, l’équilibre du pays tout entier était en danger», explique Liu Fuhe, responsable du Groupe dirigeant de réduction de la pauvreté, une agence intergouvernementale qui coordonne l’action d’une trentaine de ministères et d’administrations centrales. Le gouvernement central n’avait pas que des raisons philanthropiques pour entrer dans l’arène. Depuis le milieu des années 80, il observait avec une inquiétude croissante les conséquences de l’internationalisation des « duchés économiques » côtiers, de plus en plus intégrés aux économies du Sud-Est asiatique. On notait déjà l’existence des premiers réseaux d’interdépendance : liens privilégiés de la province méridionale de Guangdong avec Hong Kong, relations étroites de la province de Fujian avec l’île de Taiwan, en dépit des restrictions constantes du gouvernement taïwanais à l’égard des investissements sur le continent. Lancées à toute allure dans une croissance économique à deux chiffres, certaines régions côtières se laissaient gagner par la tentation d’une certaine forme de séparatisme économique…
Dès 1991, n’obtenant plus que 3 % de ses fonds de développement de Pékin, Guangdong se sentait ainsi en mesure de faire financièrement bande à part, une tendance accentuée par la fiscalité des années 80 : après avoir rempli ses obligations contracturelles selon des termes négociés pour quatre ans, chaque province pouvait alors conserver 75 % de ses revenus supplémentaires, une manne financière pour les plus riches d’entre elles, alors que le budget national devait éponger les déficits des régions à la traîne. Un exemple : au début des années 90, alors que la province pauvre intérieure du Hunan devait remettre à Pékin 1,4 milliard de yuans sur la totalité de ses recettes estimées (8,4 milliards), elle ne recevra finalement en retour que 400 millions de yuans du gouvernement central. L’enjeu était énorme, et c’est seulement après avoir sérieusement bousculé les potentats locaux méridionaux les plus virulents que Pékin réussira en 1994 à rééquilibrer les comptes de l’Etat.
Bai Enpei, gouverneur de la province occidentale du Qinghai, une province d’une très vaste superficie dans l’ouest du pays, donne la mesure du changement : « Plus de la moitié de notre région, qui est gigantesque, et où on pourrait loger plusieurs France, est inhabitable, et le reste de la province n’avait au départ aucune infrastructure. Avant la réforme, la zone qui jouxte le Tibet ne recevait que 10 millions de yuans par an pour le développement de ses infrastructures. Maintenant elle bénéficie de 100 millions. Grâce à la réforme, les ressources financières que l’Etat verse au Qinghai augmentent chaque année de 40 à 50 millions de yuans. »
Pour résorber les déficits budgétaires croissants de Pékin et assurer une meilleure répartition des ressources, le gouvernement chinois perçoit aujourd’hui 60 % des recettes; 40 % sont ensuite réservés aux dépenses au niveau central et 20 % à la redistribution des revenus vers les provinces défavorisées. Le processus de nivellement qui s’accompagne de flux d’investissements importants vers les infrastructures régionales et de fonds gouvernementaux spéciaux pour l’assistance à la pauvreté (5,5 milliards de yuans par an) commence seulement à produire ses effets : « Cette réforme est graduelle ; elle en est à ses débuts, explique Liu Fuhe. Tout l’enjeu est de déterminer le montant et l’usage des transferts de fonds selon les provinces. A notre avis, l’administration financière centrale n’a pas encore trouvé de réponses satisfaisantes aux questions que pose le transfert des ressources vers les régions intérieures. Nous nous donnons quelques années pour compléter le processus». Autre initiative, le gouvernement chinois a finalement décidé d’imposer de manière autoritaire ce qu’il demandait sans résultat depuis des années aux provinces : jeter les bases d’une meilleure coopération. Depuis l’année dernière, les provinces riches et plusieurs villes côtières se sont vues assigner le parrainage dune province retardataire de l’intérieur. Au programme, des flux d’investissements et surtout des échanges de fonctionnaires et d’expériences. Après des années d’indifférence, l’heure est enfin à la quête de complémentarité : « Cela se passe plutôt bien, explique Liu Fuhe, car il s’agit d’une démarche d’entraide mutuelle. Prenons le cas de Shanghai : s’ils veulent se développer, ils ne sont pas mieux lotis que le Japon, il leur faut des matières premières. Shanghai a les capitaux et la technologie, les régions intérieures ont les matières premières et la main-d’oeuvre à bas prix : on peut jouer sur l’effet de complémentarité. »Dans la zone de développement économique de Teda, à Tianjin, « mécène » officiel de la province de Gansu, l’un des responsables, Chen Jianping, est convaincu du bien-fondé de cette stratégie solidaire : « Nous avons déjà commencé à encourager nos entreprises à acheter leurs matières premières au Gansu, et à éventuellement y établir des filiales. Leurs fonctionnaires qui viennent en stage sont de jeunes diplômés de l’université, et on sent que ce qui leur manque surtout, c’est un accès aux nouvelles techniques et aux nouvelles méthodes de travail. Ils sont à l’affût de nouvelles idées. Ils repartent avec un bagage utile au développement de leur province. » Il suffit de regarder au-delà du centre de Pékin pour se convaincre de la nécessité d’accélérer le rééquilibrage du pays. Dans la périphérie de l’ouest de la capitale, des foules de migrants provinciaux vivent du recyclage des ordures ménagères pour quelques centimes le kilogramme. Beaucoup s’inquiètent du grossissement des poches de misère et de chômage à l’annonce de la vaste réforme des entreprises d’Etat qu’entend imposer le nouveau Premier ministre.
Les migrations intérieures, voilà bien le problème majeur d’ordre public qui se profile à l’horizon. Les millions de migrants qui sont venus accompagner la formidable mutation des régions côtières de ces dernières années n’ont pas seulement fourni la main-d’oeuvre nécessaire à la construction des usines et des immeubles de l’est de la Chine. Ils ont aussi permis à des millions d’autres Chinois – leurs familles – de survivre au loin dans leurs provinces reculées grâce à l’envoi régulier d’une partie de leurs salaires. Chaque année, cinq millions de migrants sichuanais envoient ainsi 14 milliards de yuans à leurs proches. Dans certaines régions reculées, 90 % des familles qui ont eu les moyens de construire une maison avaient des proches employés sur la côte à des milliers de kilomètres. Tout le problème désormais est de savoir quel peut être l’effet des réformes sévères qui attendent les entreprises d’Etat sur ces populations déplacées qui nourrissent une partie de la Chine. Une seule certitude : jamais les aides gouvernementales aux régions défavorisées n’égaleront le volume et la fiabilité des transferts familiaux directs. Le seul élément concret de rééquilibrage ne peut être que le maintien d’une croissance rapide du produit national. ( 1998)
 Les métropoles chinoises assiégées: une population flottante victime des réformes
Les métropoles chinoises assiégées: une population flottante victime des réformes
«Il n’y a rien de bon ici et pas grand-chose d’intéressant à en dire non plus. » On n’est pas très loin de donner raison au propriétaire de cet atelier de vestes en cuir, un local obscur éclairé toute la journée au néon, derrière une façade grillagée hermétiquement close. Une vingtaine de machines à coudre antiques tournent sans cesse. Dans cet atelier de cuir du « village Zhejiang », à l’image de centaine d’autres dans la banlieue de Pékin, les ouvriers travaillent en chuchotant, un peu comme à l’école primaire. Dans ce dédale de ruelles sombres et boueuses vivent 200 000 personnes, en majorité des travailleurs migrants de la province orientale du Zhejiang, au sud de la ville de Shanghai.
Paysans reconvertis tailleurs
Un jour normal de la semaine, la ruelle principale du quartier rappelle les villes européennes méridionales où du linge pend aux fenêtres au-dessus des marchands de rue qui vendent à la criée. Mais ici ronronnent sans cesse les machines à coudre. Les patrons des ateliers les plus prospères, ceux qui sont arrivés du Zhejiang il y a environ huit ans, se distinguent par des costumes deux-pièces impeccables, un peu anachroniques dans ces ruelles crasseuses. Mais ils ont été les premiers à comprendre tout le bénéfice qu’ils pouvaient tirer de ces paysans reconvertis tailleurs, nourris et logés sur place dans des dortoirs de fortune. En dépit de sa surpopulation et de ses rudes conditions de travail, ce village d’ateliers apparaît comme une réussite pour ces nouveaux migrants issus de la politique d’ouverture et des réformes lancée par Deng Xiaoping en 1978.
À l’heure actuelle, la force de travail en surplus dans les campagnes est estimée entre 130 et 150 millions de personnes et le gouvernement chinois prévoit 68 millions de demandeurs d’emplois dans les villes d’ici à la fin du siècle : un des défis majeurs pour la Chine dans les prochaines années.
A Shanghai, le nombre de migrants est déjà estimé à 4 millions de personnes. A Pékin, ils sont maintenant 2 millions après s’être multipliés par cinq entre 1978 et 1992. Les municipalités ont tenté de contrôler le mouvement migratoire en délivrant des permis de résidence mensuels. Mais leur coût (20 yuans ou 12F) encourage en fait la police à les renouveler pour accroître ses revenus. Le ministre du travail, Li Boyong, a admis qu’il faudrait compter cette année sur l’arrivée d’une trentaine de millions de personnes dans les villes à la recherche d’un emploi : «Un flux de cette importance posera à coup sûr des problèmes », a estimé le ministre.
Au premier rang de ces problèmes, la criminalité. Toutes les statistiques de police officielles placent la catégorie des migrants en tête des pourcentages des malfaiteurs, jusqu’à 60% dans la province méridionale du Guangdong. Même dans le village Zhejiang, le sujet met mal à l’aise. Un éclair d’hostilité passe dans les yeux de Lin Juxiang, une jeune femme énergique, propriétaire d’un minuscule atelier: « Bien sûr qu’il y a des problèmes de sécurité, surtout des vols, mais cela ne vient pas des gens de Zhejiang. Ce sont les autres, ceux de l’extérieur qui n’ont pas de travail… »
Autrement dit les nouveaux arrivants: les plus pauvres parmi les plus pauvres des migrants, marginalisés par leurs semblables devenus aisés. Ils se remarquent à peine dans les rues de la capitale chinoise mais ils sont partout , ces collecteurs de détritus vêtus de vieux vêtements couleur muraille maintes fois rapiécés, marchant lentement, les yeux rivés au sol, les bras encombrés de bouteilles en plastique ou de cartons. Quelquefois, une vieille bicyclette fait office de charrette. Une fois surchargée d’articles récupérés, le collecteur repart, traverse le centre de la ville et laisse derrière lui la ligne d’architecture moderne des bureaux et des grands hôtels pour atteindre quinze minutes plus tard une des ceintures de Pékin.
La rançon de l’industrialisation
C’est l’un des dépôts où toute une faune provinciale armée de charrettes ou de machines à peser sur pied se retrouve au milieu d’un amoncellement de bouteilles, de cartons et de papiers usagés vendus pour le recyclage. Ce jour-là, Xie, une quarantaine d’années, le visage noir de poussière, compte ses bouteilles qui à un yuan (0,60 F) l’unité vont lui rapporter 15 yuans (9 F), bien plus qu’un salaire de paysan journalier. Avec les quelques cartons qu’il a amassés et qu’il va faire peser dans un autre coin du dépôt, il n’est pas loin du revenu quotidien d’un collecteur moyen : « Peut-être 20 yuans (12 F) par jour, dit une des acheteuses de bouteilles, entourée de trois enfants débraillés. Ce n’est pas si mal pour des gens qui sont leurs propres patrons. »
Tourner le dos à un monde agricole en pleine crise pour venir travailler et dormir dans des cabanes de carton sur les dépôts d’ordures, sans perspective immédiate de retour dans les campagnes, devient ainsi l’alternative la plus logique pour des millions de paysans. Quand on lui parle de retour au pays, Xie se met à ronchonner, le regard fermé: «Je viens du Henan, et ce n’est plus un endroit où l’on peut gagner sa vie car il n’y a plus assez de terre à cultiver. »
La rançon de l’industrialisation de la Chine ne jette pas seulement des millions de paysans sur les routes mais vient nourrir chez eux de dangereuses désillusions sur les réformes : pour Xie et ses semblables, la fin de l’ère de Deng Xiaoping sera surtout vécue comme un grand bond en arrière vers le sous-prolétariat industriel. ( La Croix, 1998)
 Le nouvel an chinois à petite vapeur
Le nouvel an chinois à petite vapeur
Train Pékin-Chengdu : Personne ne parvient à marcher tout à fait normalement sur les dalles de marbre de la gigantesque nouvelle gare de l’Ouest, à Pékin. Les voyageurs glissent, atterrissent avec leurs paquets sur le tapis roulant du détecteur de métaux, se font malmener par les gardes de sécurité et trébuchent à nouveau de l’autre côté du contrôle en essayant de récupérer leurs biens. Le frémissement des départs à l’occasion du Nouvel An chinois, célébré cette année le 19 février, semble dilué dans les vastes espaces vides du bâtiment.
Les voyageurs ne se bousculent pas pour prendre leur train et plusieurs groupes sont installés à l’extérieur, face à la silhouette de paquebot du bâtiment monumental. Dans la salle des pas perdus, des tableaux électroniques futuristes indiquent les numéros de trains et de salles d’attente, contrastant avec les posters en couleurs de corps déchiquetés aux visages béants, disposés sur les murs immaculés. Un avertissement contre le transport de dynamite qui a déjà fait des dizaines de morts cette année dans les trains.
Le train s’ébranle pour Chengdu
Dans la salle d’attente, le train pour Chengdu est annoncé. Les migrants qui rentrent dans leur région natale du Sichuan pour fêter en famille le Nouvel An traversent les rangées de sièges au galop. Petits, pressés, chargés de sacs de plastique cousus main, encombrés de bagages sur des chariots roulants qui se renversent tous les deux mètres, ils disparaissent dans le couloir vers le quai. Un policier fait lever les gens en attente d’autres trains, endormis sur les sièges, avec des gestes vagues, comme pour chasser les insectes, et les relègue au fond de la salle. 23 h 08 : la quinzaine de wagons du train pour Chengdu s’ébranle au son d’une musique de cirque déversée par les haut- parleurs. Dans les sept wagons de la classe « dure » (sièges en bois), les voyageurs commencent à étaler leurs bouteilles de bière, leurs sachets plastifiés de viandes sèches et leurs paquets de nouilles instantanées. Assez pour tenir deux nuits, le dos vissé à un dossier sans complaisance, sous une lumière blafarde que l’on n’éteint jamais. « Camarades, notre vie de voyage a commencé », assure une voix féminine suave dans le haut-parleur.
Cohue matinale dans le froid de Zhengzhou
Zhengzhou, cœur céréalier et ferroviaire de la Chine, 11 heures du matin. Le train émerge tout engourdi d’une nuit glaciale, la neige enferme le centre nord de la Chine dans un écrin blanc immaculé et se transforme en boue noire sur les quais. Des silhouettes emmitouflées aux visages pâles attendent le train depuis trois heures dans le froid. Le convoi est mal en point. De la voiture supplémentaire numéro un, le contenu des toilettes se répand dans le couloir et glisse vers le quai. Il n’y a plus d’eau dans les voitures de la classe dure. Attente et silence. Les minutes s’égrènent. Deux heures passent. Les voyageurs des classes dures errent dans le train avec des bouteilles de plastique vides.
Dans la première classe, celle des couchettes « molles », plusieurs voyageurs, le front collé à la vitre sale du couloir, ont les yeux fixés sur le quai voisin, avec une expression d’incrédulité et de malaise. Ils viennent d’apercevoir un train de marchandises immobilisé, plusieurs portes encore ouvertes sur une véritable marée de migrants qui luttent pour se glisser à l’intérieur des wagons.
Des billets plus chers pour stopper les migrants
Sur le quai, des employés ferroviaires parlementent devant les portes béantes que le flot humain empêche de refermer. Deux hommes réussissent à pénétrer, tête la première, par la fenêtre supérieure de l’un des wagons, une femme hurlante est emmenée à bras-le-corps par les employés ferroviaires. Les employés tentent de dégager le reste du quai. Déjà une marée humaine menée par plusieurs gardes équipés de talkies-walkies attend en haut des escaliers pour accéder au convoi qui arrive sur la voie opposée.
Dans la classe des sièges durs, Zhang, les yeux brillants de fatigue, ne cache pas son bonheur d’avoir pu monter dans un train. Il vient d’un village à deux heures de Chengdu et il sera dans sa famille à la veille du Nouvel An, comme le veut la tradition. Pour cela, il voyage depuis exactement six jours. Il lui en a fallu deux pour joindre Pékin à partir de la province frontalière de la Russie, le Heilongjiang, où il travaille, et quatre autres pour réussir à acheter un ticket pour Chengdu. Lui et ses compagnons sont pourtant de véritables privilégiés : cette année, le gouvernement a augmenté de 60% le tarif des trains, en vue de maintenir les migrants sur leurs lieux de travail.
À nouveau le départ, sans aucun regret
« Et il n’y a pas que cela, affirme un vendeur de raviolis devant la gare de Chengdu ; le problème, c’est que les affaires ne vont pas bien, il y a moins de travail en ville et les gens ne veulent plus autant partir du Sichuan qu’auparavant.» Ils n’ont d’ailleurs pas vraiment le choix : fin janvier, le gouvernement a publié de nouveaux règlements très stricts visant à empêcher les Sichuanais, qui constituent la grande masse des travailleurs migrants, de se rendre dans les régions côtières.
Chen, et le groupe de quinze jeunes femmes qu’il accompagne dans leur village natal, sont passés à travers les mailles du filet. Ils travaillent dix heures par jour dans une usine de chaussures à capitaux étrangers, à Foshan, dans le sud de la Chine, pour 400 yuans (250 F) par mois.C’est la première fois depuis un an qu’ils rentrent dans leur village et, devant la gare routière de Chengdu, ils n’ont aucun regret. « Il n’y rien à faire ici, c’est pour cette raison que je suis parti. Là bas, on travaille comme des bêtes et on n’ a même pas le temps de se demander si c’est mieux. Ce que je sais, c’est que par ici, dans le Sichuan, quand tu as une occasion de partir, tu sautes dessus.» (La Croix, 1999)