
Deng Xiaoping 1920
« Despote sénile ›, disent certains, Deng Xiaoping vient d’écraser sous les chenilles de ses chars le mouvement qu’il avait lui-même contribué à lancer.
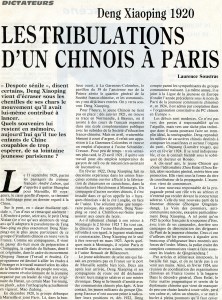 Le 11 septembre 1920, parmi les passagers du croiseur français André Lebon, qui s’apprête à quitter Shanghai pour Marseille, 85 voyageurs, le coeur gonflé d’espoir, se tiennent au bastingage pour un dernier regard à la Chine.
Le 11 septembre 1920, parmi les passagers du croiseur français André Lebon, qui s’apprête à quitter Shanghai pour Marseille, 85 voyageurs, le coeur gonflé d’espoir, se tiennent au bastingage pour un dernier regard à la Chine.
Sur le pont, en « classe étudiante spéciale », l’un d’eux se remarque aisément 1,50 mètre à peine, seize ans, le petit Deng Xixian (ce n’est qu’aux alentours de vingt ans qu’il adoptera le pseudonyme de Teng Siao-ping ou plus exactement Deng Xiaoping) est le plus jeune participant de ce groupe d’étudiants chinois en route vers la France. Comme ses compagnons, il vient de passer dix-huit mois de préparation à Chongqing, la capitale du Sichuan, dont il est originaire, dans le cadre du mouvement Qingong Jianxue (Travail et études). Ce programme est destiné à allier les études à l’étranger et le travail manuel selon les idées de la Société d’études du peuple nouveau, mouvement révolutionnaire de la jeunesse organisé par un leader de vingt ans originaire du Henan, un certain Mao Tsé-toung, ou plutôt, selon l’orthographe actuellement en vigueur, Mao Zedong.
En décembre 1920, le groupe débarque à Marseille et joint Paris. Là, dans la banlieue ouest, à La Garennes-Colombes, le pavillon du 39 de l’ancienne rue de la Pointe abrite le quartier général de la Société franco-chinoise, et les communistes y ont déjà leurs entrées. On y verra souvent Deng Xiaoping.
Pour l’heure, le jeune Chinois ne tient pas en place : dès janvier 1921, on trouve sa trace en Normandie, à Bayeux, où il assiste à des cours de français organisés dans une école complémentaire publique avec les subsides de la Société d’éducation franco-chinoise. Mais en avril, vraisemblablement à court d’argent, il refait son apparition à La Garennes-Colombes et trouve un emploi d’ajusteur à l’usine Schneider- Creusot. Pour peu de temps : trois semaines plus tard, le 23 avril 1921, il quitte son travail pour des emplois temporaires de garçon de café ou de mécanicien-assistant de locomotives.
En février 1922, Deng Xiaoping fait sa deuxième expérience dans les usines françaises comme ouvrier affecté à la fabrication de chaussures en caoutchouc, dans la manufacture Hutchinson à Montargis. En compagnie d’autres ouvriers chinois, il s’est installé dans ce qu’on appelle les « baraques chinoises » de la cité Langlée, en face de l’usine. Une solution plus que temporaire puisque, dès septembre, Deng Xiaoping se rend à Châtillon-sur-Seine pour assister aux cours du lycée.
A-t-il tellement changé à son retour à Montargis le 2 février 1923 ? En tout cas, la direction de l’usine Hutchinson paraît refroidie à son égard, le jugeant récalcitrant et contestataire. Deng Xiaoping est le seul à être renvoyé en mars 1923. Après quelques mois à Montargis, il rejoint Paris et travaille dans diverses usines, notamment à l’usine Renault de Billancourt.
Le jeune adolescent de seize ans qui faisait ses premiers pas en France sur le port de Marseille semble bien loin. Deux ans après leur arrivée, Deng Xiaoping et ses compagnons de route ont dû déchanter devant leurs maigres salaires et une misère chronique. Deng se lie bientôt d’amitié avec des communistes chinois plus âgés. A leur contact, les jeunes militants du groupe Qin- gong Jianxue n’ont aucune peine à radicaliser leurs positions et, dès 1922, Deng compte parmi les sympathisants du groupe communiste naissant. La même année, il se joint à la Ligue de la jeunesse en Europe (fondée l’année précédente sous le nom de Parti de la jeunesse communiste chinoise) et, en 1924, il est admis par cooptation dans « l’organisation constitutive du PC chinois en Europe ».
Les débuts sont modestes. Ce n’est pas vers des postes à responsabilité qu’on l’aiguille, mais vers une tâche plus technique dont il saura pourtant faire un tremplin idéal, la ronéographie. Deng reproduit les milliers de caractères chinois destinés à composer les manifestes et surtout l’organe du parti, Chiguang (Lumière rouge), qui sort en février 1924. Il se rend indispensable, et on le connaît bientôt sous le sobriquet de docteur en Ronéo.
A dix-neuf ans, le jeune Chinois qui côtoie l’éditorialiste Zhou Enlai (Chou Enlai), alors secrétaire général, mérite bien une promotion. Elle vient sous la forme du titre de coordinateur de la propagande. L’ascension vient de commencer.
Le tout nouveau responsable de la propagande prend son rôle très au sérieux et n’entend pas reculer devant la concurrence adverse. Celle du tout nouveau parti de la Jeunesse chinoise (Zhonguo Qingniandang), La Voix des pionniers, anticommuniste notoire, exaspère particulièrement Deng Xiaoping. A tel point qu’en 1925 la police française le soupçonne d’être, avec trois de ses camarades, derrière une campagne de dénonciation des dirigeants du Parti de la jeunesse chinoise. Ceux-ci ont d’ailleurs été les premiers à signaler avec beaucoup d’obligeance leurs ennemis aux forces de l’ordre. Mieux, la police craint des complots communistes visant à faire assassiner les leaders de Qingniandang !
Par articles et éditoriaux interposés, la bataille fait rage, et on ne tarde pas à en venir aux mains. Ainsi, en février 1924, une réunion de coordination des organisations chinoises en France tourne à la bagarre. Dans le désordre général, Zhou Enlai, le futur maître pragmatique et serein de la diplomatie chinoise que vient de manquer de peu une chaise lancée à toute volée, perd son calme et, selon un témoin, « se met à hurler à pleins poumons qu’il faut cesser immédiatement ces actes de violence ».
Malgré cette reprise en main, les ressentiments demeurent vivaces et les militants circulent armés. Zhou Enlai l’éprouve lui- même en échappant de justesse à une tentative d’assassinat quelques mois plus tard. A cette date, de nombreux communistes rejoignent la Chine pour travailler aux côtés de Sun Yat-sen à la direction du Guomindang (Kuomintang). Zhou Enlai rembarque bientôt à Marseille, sans doute à la grande joie de Deng Xiaoping, qui voit dans ce départ un nouvel accélérateur à sa carrière dans le Parti.
Il ne se trompe pas : en août 1925, il est nommé inspecteur délégué aux côtés de Fu Zhong, de sept ans son aîné, le remplaçant de Zhou Enlai au secrétariat général de la branche européenne du Parti communiste chinois.
La promotion du jeune communiste est marquée par plusieurs discours publics — autant qu’on puisse en juger au vu du nombre désormais limité de sympathisants dans la communauté. Avec tous ceux qui ont été cantonnés jusque-là aux seconds rôles techniques, il forme une nouvelle génération de leaders destinée à combler les vides laissés par les déportations et les départs. Signe de cette évolution, il déménage en août 1925 et s’installe au 3 de la rue Casteja, un hôtel de Billancourt qui ne loge que des Chinois. Il partage la chambre 5 avec deux de ses compatriotes, dont Fu Zhong, le secrétaire général, natif comme lui du Sichuan. Les trois hommes paraissent se consacrer aux mêmes activités et la police, qui les surveille de près, note dans un de ses rapports que « deux compatriotes vivent avec Teng-HiHieng (Deng Xiaoping) et semblent partager les mêmes opinions politiques. Ils l’accompagnent toujours quand il sort ». On peut en déduire que, dès ce moment, le jeune Deng apparaît aux observateurs comme l’un des véritables leaders du mouvement. L’est-il réellement ou le subterfuge est-il destiné à protéger Fu Zhong ?
Toujours est-il que, le 24 octobre 1925, Deng Xiaoping prend la parole devant un auditoire de communistes chinois à Issy-les- Moulineaux. Trente-cinq personnes assistent à la réunion et on évoque la reconstruction du groupe communiste élagué par les déportations.
Enfin, le 3 janvier 1926, Deng se fait l’avocat de la fraternisation avec l’URSS devant 70 personnes réunies à l’initiative du Comité d’action des groupes chinois en France (constitué le 7 juin 1925 à l’instigation des communistes pour soutenir le mouvement du 30 mai).
La réunion se clôt par le vote d’un ultimatum destiné à l’ambassadeur chinois, Chen Lu : il devra « adresser des protestations au gouvernement ainsi qu’aux corps diplomatiques à Paris contre leur impérialisme ». Le diplomate est, de surcroît, sommé de télégraphier à ses homologues à l’étranger pour leur suggérer la même démarche. Quelques menaces à l’adresse du malheureux Chen Lu pimentent le tout.
Cette fois, c’en est trop : les services de police, qui viennent de découvrir la véritable adresse de Deng Xiaoping, voient de bonnes raisons d’intervenir. Tôt le matin du 8 janvier, les policiers se rendent au 3 de la rue Castéja et pénètrent dans la chambre 5. La pièce est déserte. Dans un coin, des plaques et des rouleaux encreurs voisinent avec plusieurs paquets de papier vierge. La matière des numéros à venir de Lumière rouge a été abandonnée par Deng avec les ouvrages qui l’ont formé au communisme. Il y a là tout ce qu’un militant de base peut souhaiter en matière d’éducation marxiste : Le Travailleur chinois, Le Testament de Sun-Yatsen, l’A.B.C. du communisme et plusieurs journaux chinois dont Progrès, une publication du Parti communiste chinois éditée à Moscou.
La préfecture de police dépitée note laconiquement dans son rapport : « Il semble que ces personnes se sentaient soupçonnées et aient disparu précipitamment. »
Au même moment, Deng Xiaoping, Yang Pingsun et Fu Zhong, ses compagnons de chambrée, contemplent Berlin à travers les vitres embuées du Paris-Moscou qu’ils ont pris la veille, gare du Nord.
Emmitouflé, dans un froid glacial, Deng Xiaoping n’a plus rien de l’étudiant hésitant à peine sorti de l’enfance qui s’appliquait à perfectionner son français. Ses pensées et son ambition l’ont sans doute déjà précédé à Moscou, où il sait que le communiste qui s’est forgé en lui pourra poursuivre sa formation. Il n’a pas vingt- deux ans.